

Lorsqu'on contemple l'île
Robinson-Crusoé, avec son opulente végétation et ses criques accueillantes qui
semblent tout droit sorties d'un tableau de Gauguin, on envie terriblement
Robinson. Mais l'histoire réelle montre qu'il n'y a pas de quoi. Si le héros du
roman de Defoe est demeuré jusqu'au bout un gentleman, le véritable Robinson,
lorsqu'un équipage lui a enfin porté secours, portait des sandales en peau de
chèvre et avait presque perdu l'usage de la parole, se contentant d'émettre
quelques sons gutturaux proches du croassement.
Cet homme s'appelait Alexander Selkirk, et, comme le héros du roman, il était
écossais. Juan-Fernández est aujourd'hui le nom de l'archipel et était à
l'époque celui de l'île sur laquelle ce malheureux avait échoué. Elle mesure 22
km de long pour 7,3 km de large, et le gouvernement chilien l'a depuis longtemps
rebaptisée Robinson-Crusoé. Mais Alexander Selkirk est lui aussi resté dans
l'Histoire, car au milieu des années 70, on a donné son nom [hispanisé],
Alejandro Selkirk, à une autre île de cet archipel [qui s'appelait auparavant
Masafuera, à 170 km à l'ouest de l'île Robinson-Crusoé].
Durant son séjour ici, il a construit deux cabanes de bois, et si le Robinson du
roman s'était retrouvé là à la suite d'une erreur de jeunesse et à cause d'une
tempête, Selkirk ne dut cet isolement forcé qu'à son mauvais caractère. En 1704,
marin sur la corvette Cinq Ports qui effectuait un tour du monde, il n'avait
cessé de se quereller avec le capitaine. Ce dernier, las de le supporter et à la
demande même de l'irascible Ecossais, l'avait débarqué sur l'île, lui laissant
généreusement un peu de nourriture et deux gourdes pleines d'eau.
D'habitude, les "loups de mer" indisciplinés étaient abandonnés avec un pistolet
et une cartouche afin qu'un suicide leur évite de mourir de faim. Selkirk avait
refusé tout pistolet par principe, puisqu'il estimait avoir raison dans la
dispute qui l'opposait à son supérieur. Mais une fois sur l'île, quand il vit
repartir le canot, il poussa un hurlement déchirant : "Pardon, j'ai changé
d'avis !" Le capitaine lui cria en réponse : "Pas moi !" et le navire disparut à
l'horizon. Cela ne porta pas chance au Cinq Ports. Trois jours plus tard, il
tombait aux mains de pirates espagnols. L'équipage fut conduit au Pérou, jeté en
prison puis envoyé dans des mines de cuivre. Quelques années plus tard, alors
que Selkirk était déjà célèbre et arpentait fièrement son domaine écossais, ses
camarades croupissaient toujours dans les geôles espagnoles.
Mais, tout juste déposé sur son île déserte, qu'avait-il fait ? Il n'était pas
mort de faim, car, dès 1574, les Espagnols, qui connaissaient l'archipel, y
avaient laissé des animaux domestiques. Il avait donc commencé par chasser des
moutons et des chèvres redevenus sauvages, puis fini par fabriquer, au bout d'un
an, une sorte d'enclos. Il disposait d'une Bible, qu'il lisait à raison de deux
heures le matin et deux heures avant le coucher du soleil. Son seul problème
était celui des vêtements, rongés par les rats. Futé, il avait trouvé une
solution, apprivoisant en quelques mois des chats sauvages, qui l'avaient sauvé
des voraces rongeurs.
Le mirador duquel il observait l'horizon pour voir s'il y passait un navire se
trouve à 565 m d'altitude [L'île culmine à 915 m, au mont El Yunque.]. Une
plaque en son honneur y a été apposée, et, il y a quelques mois, des marins
écossais en visite sur l'île ont installé à côté une petite statue à la mémoire
de leur compatriote.
A deux reprises, des navires espagnols approchèrent, mais il préféra sa liberté
sauvage aux mines de cuivre de Bolivie et du Pérou. La troisième fois fut la
bonne [en 1708]. C'étaient les goélettes corsaires anglaises Duc et Duchesse. Au
début, personne ne voulut croire le récit de Selkirk, mais il devint vite
mondialement célèbre, et son histoire inspira Defoe, qui n'hésita pas à faire
durer vingt-huit ans l'odyssée de son personnage [au lieu de quatre ans et
quatre mois]. Le vrai Robinson, lui, rentra en Ecosse, puis effectua plusieurs
tours du monde et mourut au cours de l'un d'eux, à 47 ans, d'une fièvre
tropicale.
Assurément
c'est Michel Tournier qui a le mieux analysé les étapes par lesquelles
ont passe au travers de la solitude : nous accompagnerons notre visite de
quelques extraits de son livre :Vendredi ou les limbes du Pacifique
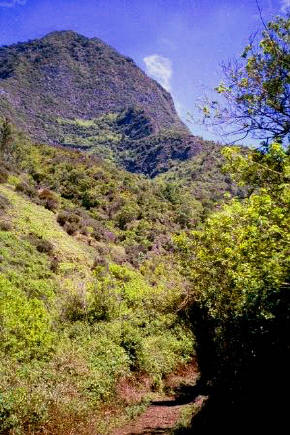


(...)" Chaque homme a
sa pente funeste. La mienne descend vers la souille. C'est là que me chasse
Speranza quand elle devient mauvaise et me montre son visage de brute. La
souille est ma défaite, mon vice.
Ma
victoire, c'est l'ordre moral que je dois imposer à Speranza contre son ordre
naturel qui n'est que l'autre nom du désordre absolu. Je sais maintenant qu'il
ne peut être seulement question ici de survivre. Survivre, c'est mourir. Il faut
patiemment et sans relâche construire, organiser, ordonner. Chaque arrêt est un
pas en arrière, un pas vers la souille.
Les circonstances extraordinaires où je me trouve justifient, je pense, bien des
changements de point de vue, notamment sur les choses morales et religieuses. Je
lis chaque jour la Bible. Chaque jour aussi je prête pieusement l'oreille à la
source de sagesse qui parle en moi, comme en chaque homme. Je suis parfois
effrayé de la nouveauté de ce que je découvre et que j'accepte cependant, car
aucune tradition ne doit prévaloir sur la voix de l'Esprit Saint qui est en
nous.
Ainsi le vice et la vertu. Mon éducation m'avait montré dans le vice un excès,
une opulence, une débauche, un débordement ostentatoire auxquels la vertu
opposait
l'humilité, l'effacement, l'abnégation.
Je vois bien que cette sorte de morale est pour moi un luxe qui me tuerait
si je prétendais m'y conformer. Ma situation me dicte de mettre du plus dans la
vertu et du moins dans le vice, et d'appeler vertu le courage, la force,
l'affirmation de moi-même, la domination sur les choses. Et vice le renoncement,
l'abandon, la résignation, bref la souille. C'est sans doute revenir
par-delà le christianisme à une vision
antique de la sagesse humaine, et substituer la virtus à la vertu. Mais le fond
d'un certain christianisme est le refus radical de la nature et des choses, ce
refus que je n'ai que trop pratiqué à l'égard de Speranza, et qui a failli
causer ma perte. Je ne triompherai de la déchéance. que dans la mesure au
contraire où je saurai accepter mon île et me faire accepter par elle. (...)

